LA DOCTRINE, SOURCE INDIRECTE DU DROIT
On appelle « Doctrine », l’ensemble des travaux écrits consacrés à l’étude du droit, et leurs auteurs. Nous verrons les modes d’expression de la doctrine (I), puis nous en envisagerons la fonction (II).
La doctrine est-elle une source de droit? On sait que les règles du droit positif émanent d’autorités diverses.
— Certaines autorités élaborent directement les règles dont elles imposent l’observation. Ce sont des sources directes des règles de droit. C’est le cas par exemple de la loi et du règlement, des traités internationaux ou des conventions européennes.
- Introduction au droit français
- L’autorité de la chose jugée
- Les principes directeurs de l’instance
- L’action en justice : définition, conditions
- Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment)
- Les preuves parfaites : écrit, aveu judiciaire, serment
- La preuve littérale : acte sous seing privé et acte authentique
- L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques
- Détermination de la charge de la preuve : qui doit prouver?
- Qu’est ce que l’objet de la preuve ?
— Les autres n’ont pas ce pouvoir et se bornent à interpréter ces règles. Ils se bornent à favoriser la compréhension et l’évolution du droit.
Par ce travail, et à des niveaux différents, ils contribuent indirectement à la construction de l’édifice du droit. Ces autorités sont des sources d’interprétation qui, dans une certaine mesure mais de façon indirecte, créent des règles de droit. c’est le cas notamment de la doctrine.
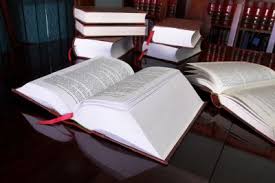
I- Les modes d’expression de la doctrine
-La doctrine ainsi entendue, recouvre des œuvres les plus diverses qui sont élaborés principalement par des universitaires, notamment des professeurs de droit, mais aussi par des praticiens, des avocats, magistrats ou notaires. On peut distinguer trois types d’écrits :
-Les ouvrages généraux consacrés, en un ou plusieurs volumes, à une branche du droit (droit civil, droit commercial, droit pénal, etc… Il existe des répertoires qui sont un exposé thématique de la matière avec une vision essentiellement pratique. Il y a également des traités qui font le point sur la matière par un exposé dogmatique et synthétique. Les manuels et précis sont construit sur la même base mais avec davantage de soucis pédagogiques et un effort de simplification.
-Les ouvrages spécialisés portant sur des thèmes limités. Ceux-ci sont des thèses de doctorat ou des monographies à finalité plus utilitaire, destinés essentiellement aux praticiens.
-Les écrits ponctuels, qui prennent la forme d’articles, d’études ou de chronique de quelques pages consacrés à un thème précis, le plus souvent d’actualité légale ou jurisprudentielle, ou de note de jurisprudence, commentant une décision de justice. (et les consultations)
II – Fonctions de la doctrine
Le voudrait-il, le législateur ne pourrait pas prévoir toutes les situations, toutes les difficultés susceptibles de naître de l’application des textes qu’il édicte.
A) Une source indirecte du droit
-L’effort considérable des rédacteurs du Code civil allemand (1900), qui ont prétendu faire œuvre scientifique (en ce sens qu’ils ont tenté de dresser un inventaire détaillé de toutes les solutions envisageables), fut une faillite. Ceci servit d’avertissement aux rédacteurs des autres codes européens.
-Il est clair que les rédacteurs du Code civil français n’ont entendu ne donner que des cadres, ne poser que des principes généraux. L’interprétation de la loi s’avère alors souvent nécessaire.
-L’interprétation de la coutume est encore plus nécessaire que celle de la loi, en raison de l’imprécision et de l’incertitude des règles créées par l’usage.
-Lorsque le juriste se contente d’appliquer purement et simplement une règle claire à une situation envisagée par le législateur, il est évident qu’il ne joue aucun rôle créateur.
-Mais ce rôle commence dès lors qu’il s’agit d’adapter le texte à un cas concret non prévu ; plus encore lorsqu’il faut donner d’un texte imprécis ou incomplet, une interprétation claire ou plus étendue. Ce rôle d’interprétation revient à la jurisprudence et à la doctrine. Cette interprétation est parfois créatrice de droit. la doctrine (mais aussi la jurisprudence) sont donc des sources indirectes de droit.
B) Un rôle de commentateur, de critique des textes
– Philippe Jestaz nous dit, dans son ouvrage (Le droit, Connaissance du droit), que « pour mesurer le rôle de la doctrine, il suffit en guise d’expérience de faire lire le Code civil à un non-juriste : c’est, à en croire le prédécesseur de Knock, un bon remède contre l’insomnie. Le malheureux ne comprendra rien, -si ce n’est qu’il faut plusieurs années pour former un juriste ! Or, la doctrine joue précisément ce rôle de commenter chaque texte, en lui-même, en le confrontant avec la réalité sociale et surtout en le rapportant aux autres textes. La doctrine édifie un ensemble explicatif. » Il a donc un rôle pédagogique.
-Mais les juristes ne doivent pas se contenter d’étudier et de commenter la règle écrite. Ils ne peuvent se contenter d’en être l’interprète, d’étudier les institutions juridiques seulement de lege lata (ce qu’elles sont) mais aussi de lege ferenda (ce qu’elles devraient être). Ils doivent en rechercher les défauts. Ils ont le devoir de montrer au législateur le défaut de la règle de droit afin que celui-ci intervienne pour la modifier. La doctrine est une force de proposition. S’inspirant de l’histoire et du droit comparé, le juriste doit proposer des règles meilleures, plus adaptées aux besoins sociaux et économiques. En ce sens, la doctrine participe à la création de la règle de droit ou plus exactement à son perfectionnement. Le juriste a pour mission d’aider à la création de la règle de droit, telle qu’elle se rapproche le plus possible de l’idéal de justice.
-Le législateur est influencé par la doctrine. Le plus souvent, les projets ou proposition de lois sont rédigés avec la collaboration étroite de professeurs de droit et de praticiens. C’est ainsi que l’influence du Doyen Jean Carbonnier a été très importante dans le mouvement de rénovation du droit civil français qui s’est développé depuis les années 1960. Les juges aussi, se réfèrent aux travaux de la doctrine lorsqu’ils sont chargés d’appliquer une règle de droit au contenu obscur. Ils tiennent également compte des critiques adressées par la doctrine et convaincus, ils modifient parfois leur jurisprudence. Ainsi, Saleilles et Josserand ont exercé une influence majeure sur la formation de la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses (Article 1384 al. 1er).
Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)
- Cours complet d’Introduction au droit Application de la loi en Alsace-Moselle et Outre-mer Définition et rôle de la doctrine juridique Distinction entre droit interne, droit international et droit européen Droit privé, droit public et droit mixte Entrée en vigueur, abrogation et force obligatoire de la loi La notion de coutume et sa fonction La primauté du droit international dans l’ordre interne La règle de droit est obligatoire, générale, permanente Le juge et la jurisprudence, créateurs de droit? Le principe de non-rétroactivité des lois L’autorité de la chose jugée L’interprétation juridique de la règle de droit par le juge
- Notion de patrimoine : théorie classique et moderne Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs? Quelle différence entre droit, religion, équité et morale? Quelle différence entre la loi et le règlement? Comment distinguer droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux? Détermination de la charge de la preuve : qui doit prouver? La distinction entre droits réels et droits personnels L’action en justice : définition et conditions L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques L’écrit ou preuve littérale, une preuve parfaite Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment) Qu’est ce que l’objet de la preuve?
- Quelle différence entre magistrat du siège et du parquet ? Les juridictions administratives Les juridictions européennes (CEDH, CJUE et TPIUE) Les principes directeurs de l’instance Présentation des juridictions pénales La cour d’appel : organisation, rôle, formation La Cour de cassation : Rôle, composition et formation Le Conseil constitutionnel : origine, rôle, composition TGI : compétence, composition, organisation Tribunal de Commerce : compétence, organisation, composition Le tribunal de proximité : Compétence, organisation, composition Le Tribunal des conflits : origine, rôle, composition Le tribunal d’instance : compétence, organisation, composition Le tribunal paritaire des baux ruraux
